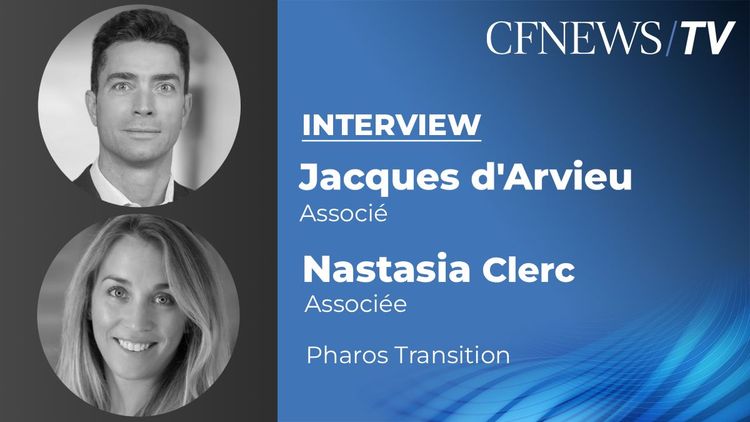Pour respecter ces droits de propriété intellectuelle, je vous suggère de :
- Contacter directement CFNEWS pour obtenir l'autorisation de traitement
- Demander un résumé officiel auprès de l'éditeur
- Consulter d'autres sources d'information sur le même sujet qui ne seraient pas soumises à ces restrictions
Je reste disponible pour vous aider avec d'autres contenus qui ne présentent pas de telles restrictions de droits d'auteur.

Didier Sensey, Meaneo
Le private equity vit un moment charnière. Après une décennie marquée par l’abondance de capitaux, la baisse continue des taux d’intérêt et un environnement de valorisation favorable, les fonds se retrouvent face à une réalité nouvelle : ralentissement des exits, pression accrue des investisseurs pour des distributions immédiates et instabilité macroéconomique persistante. Les chiffres parlent d’eux-mêmes : selon Bain1, plus de 3 000 Md$ d’actifs attendant leur sortie restent aujourd’hui en portefeuille à l’échelle mondiale. La durée moyenne de détention a grimpé de cinq à près de sept ans, signe d’un marché grippé où les acheteurs et les vendeurs peinent à s’accorder sur des valorisations crédibles.
Cette situation reflète un paradoxe saisissant : jamais le secteur n’a eu accès à un tel niveau de capital (la fameuse dry powder s’élève à près de 2 600 Md$) mais rarement les conditions de déploiement et de sortie n’ont été aussi complexes. L’incertitude économique, la volatilité géopolitique et la hausse durable des taux d’intérêt ont fait voler en éclats le moteur classique de création de valeur. Les performances en pâtissent : selon France Invest2, le TRI net à dix ans en France est passé de 13,7 % à 12,4 % entre 2023 et 2024, tandis que celui à trois ans s’est effondré de 13,6%, à 5,3 % sur la même période. Pour certains LPs, le constat est clair : « le DPI devient le nouveau IRR ». En d’autres termes, ce qui compte désormais, c’est le cash réellement distribué, bien plus que les performances théoriques affichées sur le papier.
Dans ce paysage bouleversé, une conviction émerge avec force : la valeur ne peut plus se construire uniquement sur l’ingénierie financière et les modèles du passé. Les leviers historiques comme celui facilité par la dette bon marché, l’expansion mécanique des multiples ou les build-up systématiques, ont atteint leurs limites. La valeur « technique » s’amenuise et c’est désormais sur le terrain, au cœur des opérations, que se joue la bataille.
Les défis contemporains : un monde VUCA3 accéléré
Les entreprises évoluent désormais dans un monde plus que jamais volatile, incertain, complexe et ambigu (VUCA). Cette grille de lecture résume bien la réalité des fonds aujourd’hui : des chocs fréquents, une visibilité réduite, des interactions multiples entre facteurs et des interprétations contradictoires qui rendent les décisions plus difficiles à trancher. Dans un tel contexte, où la vérité du jour n’a jamais semblé aussi éloignée de celle du lendemain, les cycles et les horizons classiques d’investissement sont devenus plus incertains. Le temps devient un facteur critique : il ne s’agit plus seulement d’anticiper les transformations, mais de les intégrer à un rythme beaucoup plus rapide qu’auparavant. Dans ce monde nouveau où l’absence de visibilité est la norme, on distingue malgré tout trois mégatendances lourdes qui, à défaut de rendre le futur plus lisible, permettent de structurer les décisions et d’orienter les choix.
La première est l’urgence environnementale. Depuis l’Accord de Paris et en dépit des vicissitudes politiques et règlementaires actuelles, la prise en compte des enjeux climatiques s’est imposée comme un horizon incontournable. Les réglementations se sont multipliées, du Pacte Vert européen à la CSRD en passant par les devoirs de vigilance. Les clients, les talents, les banques et les investisseurs attendent des pratiques responsables et transparentes, transformant l’impact environnemental d’un facteur externe en un critère à prendre en compte dans la stratégie pour assurer la compétitivité de l’entreprise. Pour les participations, cela ne se traduit plus seulement par des obligations de reporting sur la réduction des émissions, mais par la nécessité d’adapter voire de transformer les modèles d’affaires afin de préserver leur place sur le marché.
La deuxième est la révolution technologique, portée à la fois par l’essor de l’intelligence artificielle et par les vulnérabilités qu’elle génère. L’IA générative promet des gains de productivité spectaculaires, de nouveaux modèles de services et une transformation des métiers à forte valeur ajoutée. Mais elle est accompagnée de conséquences sociales majeures, accentue la dépendance vis-à-vis des acteurs technologiques dominants et accroît l’exposition aux cyberattaques. La donnée devient à la fois un levier de valeur et un talon d’Achille. Pour les fonds, la question n’est plus de savoir s’il faut intégrer l’IA, mais comment l’adopter rapidement tout en sécurisant les actifs numériques et en préservant le capital humain de l’entreprise.
La troisième est la fragmentation géopolitique et sociale, qui marque la fin d’une mondialisation linéaire et « heureuse ». L’invasion de l’Ukraine, les tensions sino-américaines ou encore la pandémie ont révélé la dépendance critique des chaînes d’approvisionnement. Beaucoup d’entreprises envisagent désormais des relocalisations partielles ou des stratégies de diversification (friendshoring) pour réduire leur exposition aux chocs extérieurs. Mais cette fragmentation n’est pas seulement géopolitique : elle est aussi sociale. Les inégalités économiques et territoriales s’accroissent, nourrissant des attentes polarisées entre des collaborateurs en quête de sens et d’équité et des tensions liées aux écarts de conditions de travail ou de rémunération.
Ces mégatendances, environnementale, technologique, géopolitique et sociale, s’entrecroisent et se renforcent mutuellement, constituant un véritable système interdépendant. Pour les dirigeants de participations, l’enjeu est d’élaborer une vision systémique et d’intégrer ces dynamiques dans leur stratégie. Pour les fonds, cela implique de repenser leurs outils de due diligence, leurs grilles de création de valeur et des indicateurs de performance ainsi que leur capacité d’accompagnement, afin de préparer des entreprises capables de résister, de s’adapter et de prospérer dans cet environnement radicalement instable.
Vers une création de valeur globale, durable et partagée
Ce diagnostic rejoint les constats formulés par Bain, Hekzé et meaneo4 : dans un monde VUCA, les leviers financiers classiques s’érodent et les fonds doivent redéfinir leur manière d’aborder la création de valeur. Il ne s’agit plus seulement de renforcer la performance opérationnelle par des réorganisations, des gains de productivité ou des digitalisations ciblées, mais d’élargir la focale. La véritable promesse repose désormais sur la création de valeur globale et durable, qui articule performance économique, impact sociétal et robustesse stratégique.
Cette vision prolonge la logique de la création de valeur partagée (CVP)5 théorisée par Michael Porter : l’entreprise ne créera de la valeur durable pour l’actionnaire que si elle contribue, en parallèle, à renforcer son écosystème de parties prenantes. En prenant mieux en compte leurs attentes, elle génère un effet « Grow the Pie6 » : l’entreprise est plus robuste car elle fédère mieux son écosystème, ce qui garantit in fine une création de valeur financière plus importante pour l’actionnaire. Autrement dit, en agrandissant le gâteau pour tous, la part qui revient aux investisseurs devient elle-même plus conséquente.
C’est dans ce cadre élargi que les pratiques des fonds doivent évoluer. Les plus avancés industrialisent déjà leurs méthodes, mobilisent la data pour piloter en temps réel, ou associent des experts dès la due diligence. Mais la clé n’est pas seulement méthodologique et technique : elle est avant tout humaine. Or, les équipes d’operating partners mobilisées par les fonds restent le plus souvent composées de profils salariés, issus de la finance ou du conseil, dont la légitimité auprès des dirigeants est parfois limitée et trop souvent perçue avec méfiance. Beaucoup de CEOs de PME et d’ETI attendent autre chose : un partenaire qui comprend leur métier, les aident à décoder un environnement complexe, parle leur langage et qui est audible pour avoir lui même expérimenté toutes les difficultés du métier de dirigeant.
C’est pourquoi nous plaidons pour un modèle complémentaire : celui d’operating partners indépendants, porteurs d’une triple promesse. D’abord, une légitimité forte de dirigeant, qui crée une crédibilité immédiate auprès des équipes en place. Ensuite, une expertise sectorielle fine, capable de décoder les dynamiques propres à chaque filière et d’identifier les vrais leviers de transformation. Enfin, une expertise sur les nouveaux enjeux sociaux, sociétaux et environnementaux. L’operating partner ne doit pas être un «consultant bis», mais un tiers de confiance indépendant, capable de soutenir les dirigeants dans leur trajectoire et de traduire cette recherche de valeur partagée en résultats tangibles.
La pression des LPs : intégrer des entrepreneurs
Cette attente n’est pas seulement exprimée par les entreprises en portefeuille. Elle vient aussi des LPs eux mêmes. De plus en plus, les grands investisseurs institutionnels demandent aux fonds d’intégrer des profils entrepreneurs dans leurs équipes opérationnelles. Ils veulent s’assurer que la création de valeur ne repose pas uniquement sur des modèles financiers, mais qu’elle s’enracine dans une compréhension incarnée de la réalité entrepreneuriale. Des enquêtes récentes, comme celle menée par Hekzé, montrent que cette exigence devient un critère différenciant dans la sélection des GPs. Lors des due diligences de fonds, certains LPs intègrent déjà des scorecards internes pour évaluer les compétences opérationnelles des équipes, au-delà de leur track-record financier. Autrement dit, la question n’est plus seulement « combien avez-vous rapporté ? » mais bel et bien « comment créez-vous concrètement de la valeur aux côtés des dirigeants ? ».
Devant une telle évolution, la due diligence change de nature. Elle ne peut plus se limiter à cocher des cases de conformité. Elle doit devenir un acte fondateur, qui identifie non seulement les risques mais aussi les potentiels, prépare la transformation et engage les dirigeants dans une trajectoire. La différence entre un fonds qui subit les cycles et un fonds qui construit la valeur de demain réside là : savoir documenter une feuille de route, mobiliser les équipes et initier une vision partagée dès l’amont.
Un mouvement de fond
Tout converge vers une idée centrale : la création de valeur doit devenir globale. Elle ne peut plus se limiter à l’équation rendement/risque, mais doit conjuguer performance économique, impact positif et robustesse stratégique. Ce mouvement est profond et dépasse largement les vicissitudes politiques et réglementaires. Malgré le backlash de l’administration US sur l’ESG, The People’s Pension, fonds de pension britannique7 a transféré en mars 2025, 35 Md$ de State Street vers Amundi et Invesco, recherchant un alignement plus fort avec la durabilité. Début septembre 2025, PFZW, autre fonds de pension néerlandais8 a retiré 14 Md€ de BlackRock pour les mêmes raisons. Ces décisions confirment que les investisseurs de long terme, soumis au regard du public, savent que négliger la durabilité revient à compromettre la valeur future. Ces décisions constituent un marqueur fort démontrant que ces enjeux sont de puissants vecteurs de décision et de création de valeur future pour les fonds d’investissements.
Le private equity n’est pas condamné à la stagnation mais il est à la croisée des chemins et doit se réinventer. Cela suppose de dépasser le confort des anciens modèles, de renforcer les équipes opérationnelles de leurs participations, de doter les équipes de moyens adaptés, d’intégrer des dirigeants partenaires au cœur de la création de valeur à toutes les étapes de la vie des participations, comme un engagement stratégique de long terme. La finance est un puissant levier de transformation des entreprises et les fonds doivent prendre leur part de responsabilité en assumant pleinement leur rôle sociétal auprès des dirigeants, car leur modèle ne pourra perdurer qu’à la condition de démontrer qu’il s’inscrit dans une démarche de durabilité sincère et engagée.
Le moment est venu de prendre la vague, non pas en espérant un retour du marché d’hier, mais en apprenant à naviguer autrement, avec plus de profondeur, de rigueur et d’ambition. C’est à ce prix que la promesse du private equity pourra continuer à séduire investisseurs, dirigeants et devenir un réel vecteur, non seulement d’accompagnement des entreprises, mais de transformation de la société.
1 Bain Global Private Equity Report 2025 : https://www.bain.com/insights/topics/global-private-equity-report/
2 France Invest Juillet 2025 : https://www.franceinvest.eu/wp-content/uploads/2025/07/France-Invest-Etudes-2025_Performance-2024.pdf 3 VUCA : https://fr.wikipedia.org/wiki/Volatility,_uncertainty,_complexity_and_ambiguity
4 meaneo / CF News : https://www.cfnews.net/L-actualite/Marche-General/Paroles-d-expert/Private-Equity-Il-est-temps-de-repenser-les-promesses-de-la-creation-de valeur-528359
5 Creating Shared Value – Harvard Business Review : https://hbr.org/2011/01/the-big-idea-creating-shared-value
6 Grow the Pie - Alex Edmans - Dunod
7 Financial Times https://www.ft.com/content/541c715b-d518-49c3-9838-1cf8d3fb73e5?utm_source=chatgpt.com
8 Reuters : https://www.reuters.com/sustainability/climate-energy/dutch-fund-pfzw-reduces-blackrock-ties-over-clash-sustainability-2025-09-03/?utm_source=chatgpt.com